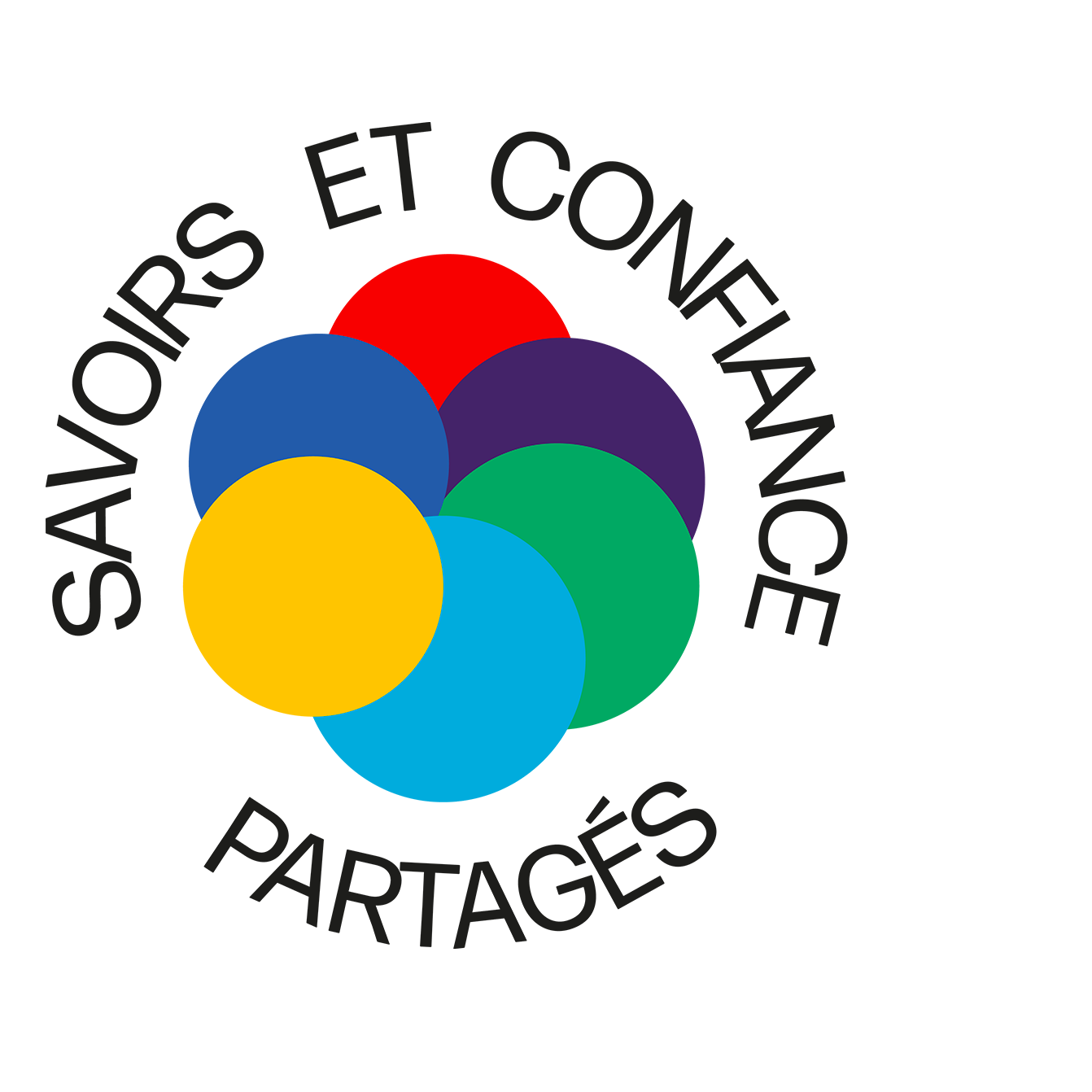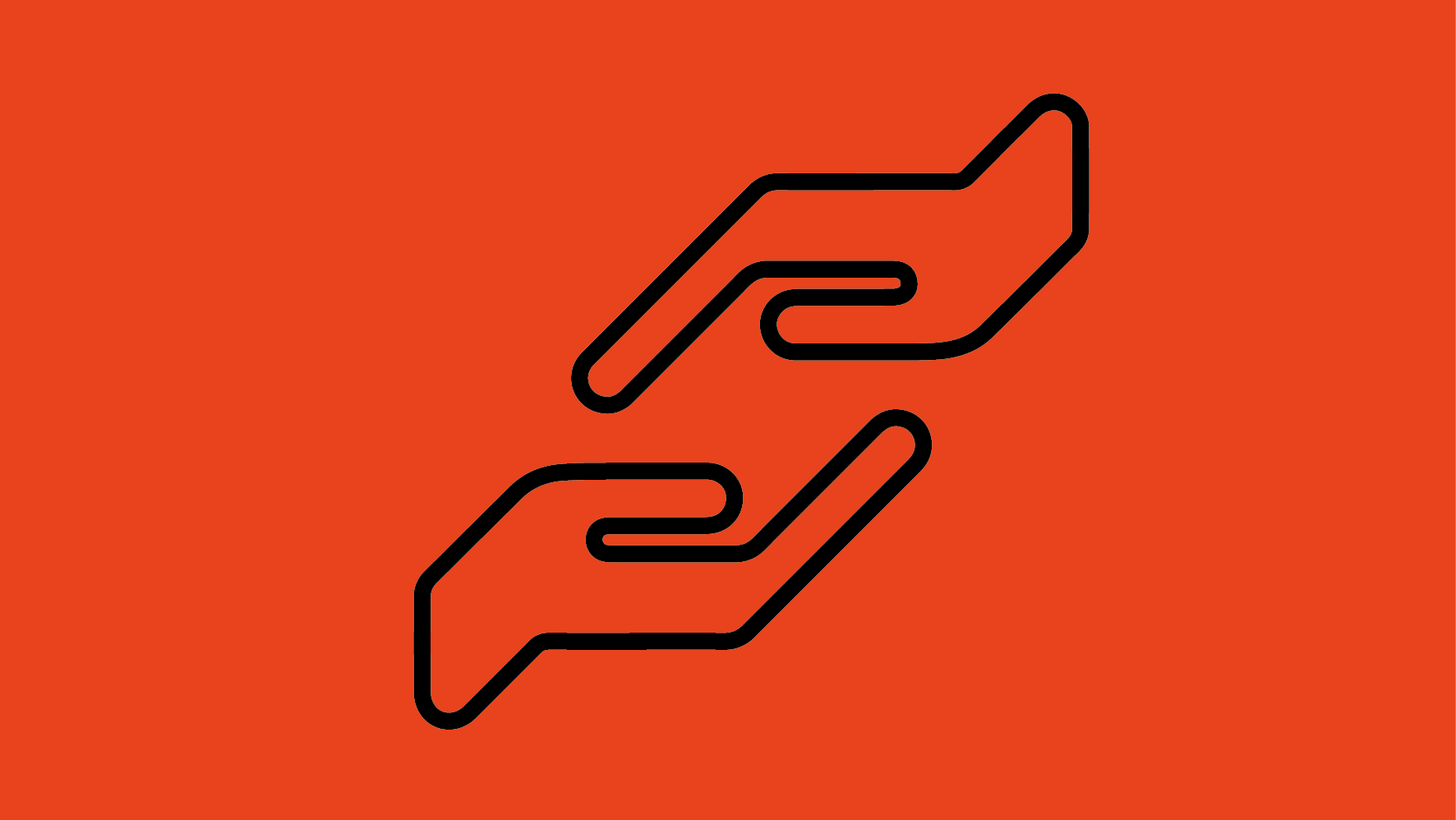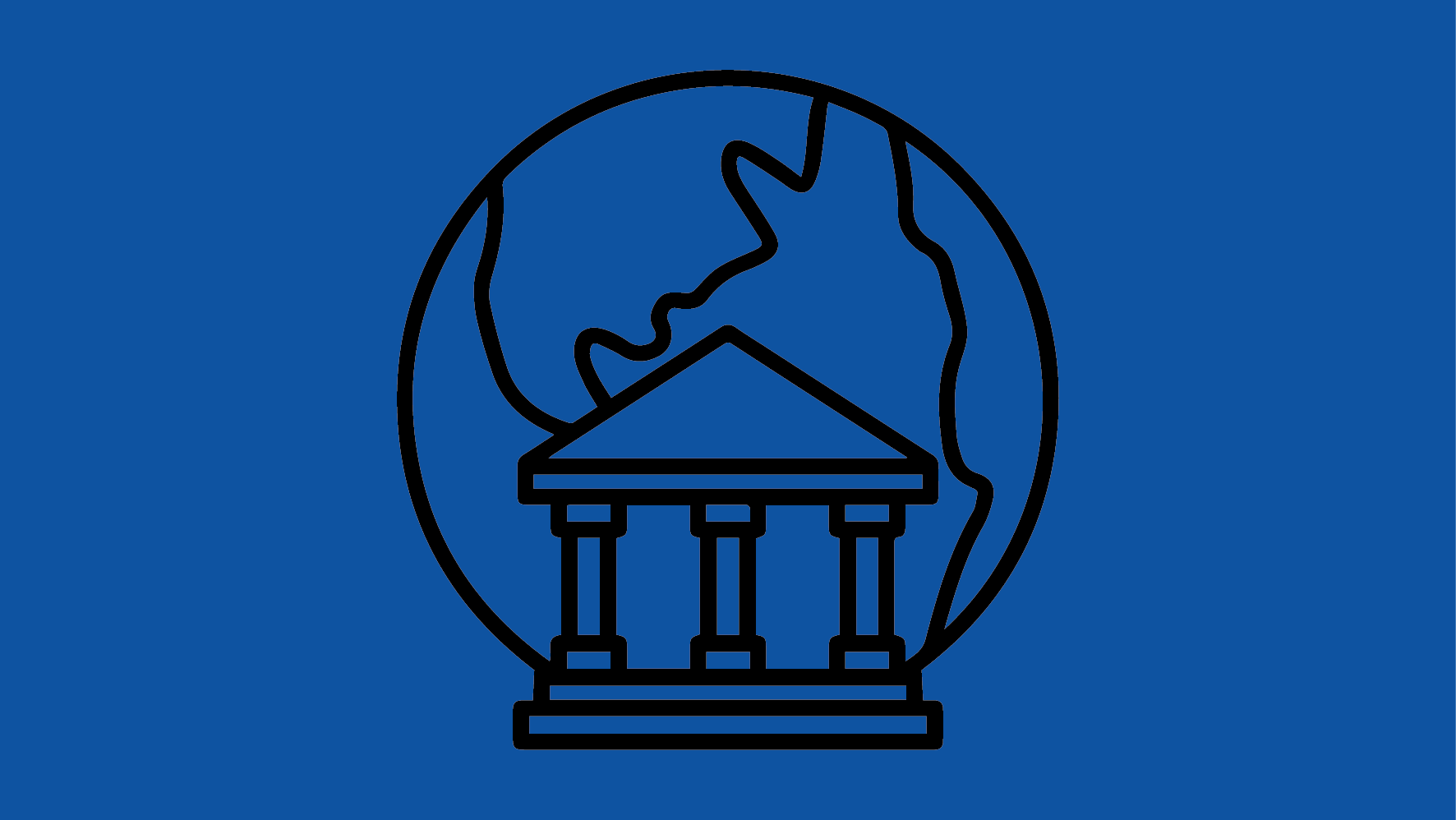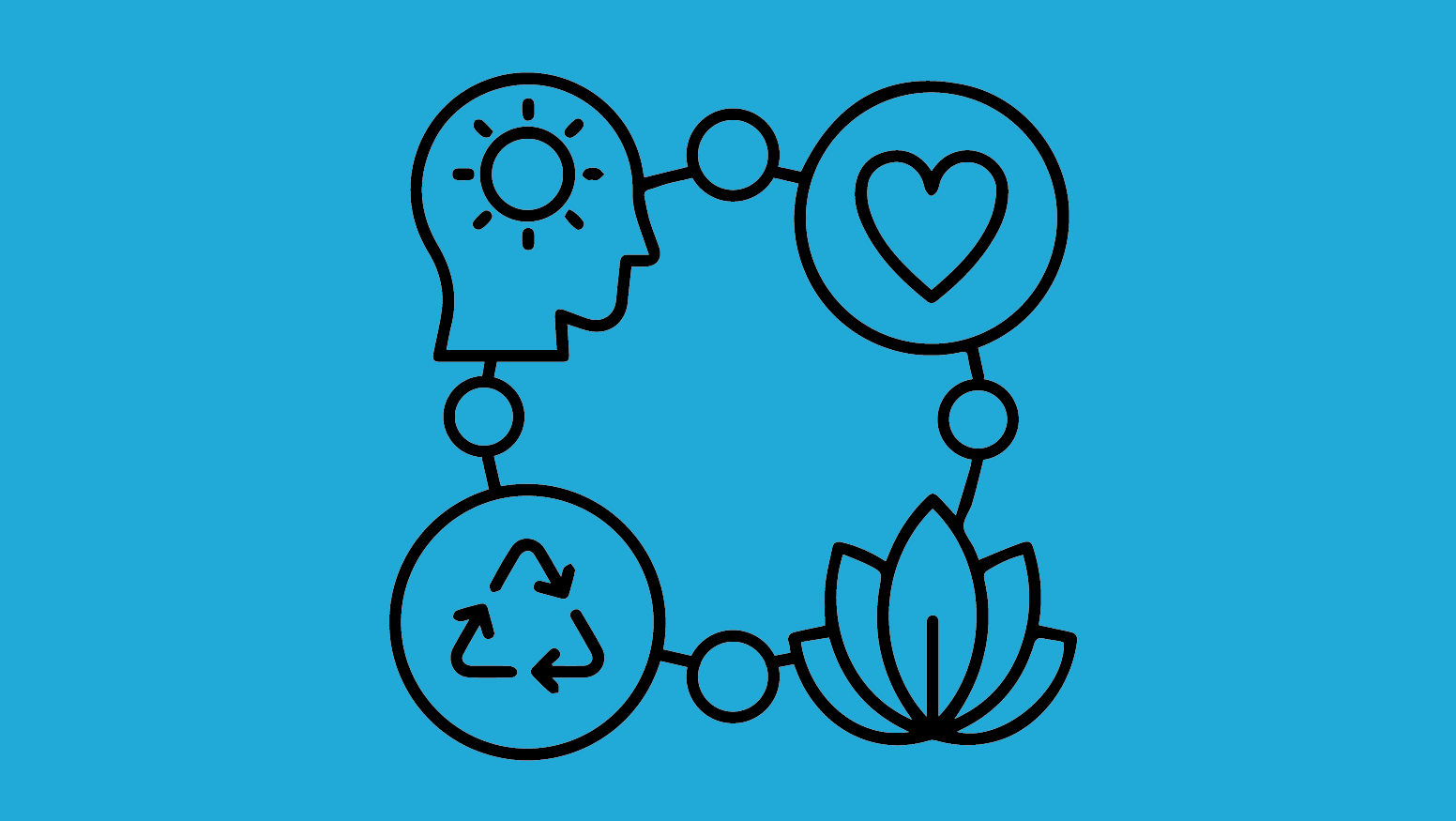Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’une des plus grandes universités françaises de recherche en Sciences Humaines et Sociales. Après plusieurs années de fragilisation, elle a retrouvé sa place centrale dans l’écosystème de la recherche en Ile de France et au-delà, à l’échelle nationale et internationale. Cette reconnaissance est le fruit de la qualité et de la diversité des travaux de menés dans l’ensemble de nos laboratoires ainsi que de notre engagement déterminé dans les partenariats scientifiques, dans les appels à projet, dans la formation à la recherche, dans la diffusion de nos travaux.
Mis en place par l’administration provisoire en 2020, la Direction des Projets et de la Prospective (D2P) a permis à Paris 1 de développer une politique volontariste de réponse aux appels à projets lancés par l’UE, l’État et les Régions. L’équipe présidentielle sortante a mené une politique ambitieuse de ce point de vue et celle-ci a commencé à porter ses fruits. Les projets des plans d’investissement d’avenir (PIA), et notamment Sorb’Rising, ouvrent des perspectives importantes pour les années 2024-2028.
Il faut maintenir cette dynamique. Mais une politique de soutien à la recherche ne peut se résumer à un chiffre d'euros récoltés. La recherche scientifique ne doit pas se réduire à la recherche de moyens financiers et tous les travaux de recherche ne rentrent pas dans le format de la recherche par projet. Ensuite parce qu’une politique de soutien à la recherche par projets, pour être pleinement efficace, suppose une stratégie de soutien aux enseignants-chercheurs et ESAS dans toutes leurs activités afin qu’ils et elles dégagent du temps. Cela est d’autant plus nécessaire dans l'optique d'une projection internationale de nos recherches.
Or nous sommes nombreux à faire le même constat. Notre identité de chercheur est remise en cause par la lourdeur de tâches administratives de plus en plus chronophages (Parcoursup, Mon Master, comités de thèse, évaluations de projets et de collègues, etc). Un projet politique ambitieux pour la recherche à Paris 1 doit agir sur différents leviers pour augmenter l’insertion des enseignants chercheurs dans des projets et assurer une meilleure valorisation des résultats. C’est le sens des propositions que nous faisons.
Maison Française d'Oxford - Jpbowen
Université de Columbia à New York - @nitouche_a_newyork
PORTER Une politique SCIENTIFIQUES AMBITIEUSE :
- La politique de réponse aux appels à projets régionaux, nationaux et européens doit être poursuivie, renforcée et complétée. Complétée par un soutien à d’autres formes de partenariats scientifiques avec les acteurs locaux, le tissu associatif, le monde économique, les pouvoirs publics. Complétée par un dispositif de soutien spécifique à des recherches innovantes qui n’entrent pas dans les thématiques imposées verticalement par les appels à projets ou les partenariats structurants. Renforcée afin de mieux accompagner les porteurs dans le montage des projets (ANR, ERC, AAP régionaux, etc…) avec l’ambition de développer un accompagnement au portage de projets sur le temps long de la mise en œuvre, de la gestion quotidienne jusqu’aux rendus finals.
- Notre insertion dans l’écosystème de la recherche doit être dynamisé. Cela passe par le renforcement de nos relations avec les organismes de recherche, en privilégiant les formats durables et agiles. En premier lieu avec le CNRS mais aussi avec les autres établissements notamment l’IRD, l’Ined, l’Inserm et l’EHESS. Il est fondamental également de jouer pleinement un rôle moteur dans les dynamiques de recherche sur nos sites structurants (Campus Condorcet, Sorbonne Alliance, Campus Jourdan). Cela passe également par une politique de soutien aux mobilités. En soutenant nos UMR et en renforçant la mobilité entre les fonctions d’enseignement et de recherche. Il faut continuer à soutenir les projets de délégations de recherche et développer significativement l’accès aux CRCT pour les EC mais aussi avancer vers la création, dans l’autre sens, d’un statut de professeur ou MCF rattaché pour les DR et CR qui pourraient venir s’investir dans nos formations.
- La politique de relations internationales doit se poursuivre. L’alliance UNA Europa a été fondée sous la mandature précédente et consolidé dans sa structure et sa gouvernance par l’équipe actuelle. Il faut désormais rapprocher les laboratoires et la formation doctorale des différentes universités et élaborer collectivement les thématiques qui peuvent être portées par le réseau. Ce partenariat très important ne doit pas conduire à négliger les partenaires qui ne sont pas dans son périmètre notamment Europaeum.
- Au-delà de son ambition de rayonnement international, dans le contexte de crise géopolitique mondiale actuel, l’université doit continuer à faire vivre le multilatéralisme et à préserver les liens entre les pays du Nord et des Suds. En soutenant la mobilité internationale, en maintenant des relations avec les universités du continent africain, en favorisant l’accueil des enseignant.es et étudiant.es étrangers et exilé.es.
- Il faut enfin soutenir la francophonie dans les SHS, par une aide plus importante à la traduction en anglais pour mieux faire connaître la production scientifique francophone, mais aussi en collaborant activement avec Campus France, l’Alliance Française, l’Agence universitaire de la Francophonie et les sociétés savantes. Il faut maintenir les conventions établies avec les pays francophones et les multiplier pour que rayonne la francophonie, malgré les aléas de la géopolitique.
- Il est essentiel développer avec les bibliothèques et les archives une politique raisonnée de conservation et de valorisation des archives de la recherche et des chercheurs, en collaboration notamment avec l’Humathèque du Campus Condorcet. Et plus largement, d’associer nos bibliothèques aux appels à projets, de trouver des solutions aux problèmes de stockage et de poursuivre une politique volontariste d’accès aux données et aux bouquets d’autres disciplines en partenariat avec nos différents sites.
- Il s’agit enfin de favoriser l'adossement de l'université à une SATT, société d'accélération du transfert de technologies, pour développer une politique de brevet et d'innovation.
ISST à Bourg-la-Reine
IEDES à Nogent-sur-Marne
CONTINUER DE Mieux environner la recherche :
- Soutenir les équipes de recherche et les laboratoires dans le suivi de leurs activités. Mettre en place l’accompagnement au portage des projets, et pas seulement au montage, notamment sur le plan financier pour alléger la charge de reporting, en créant une cellule ad hoc avec des référents sur chaque site. Améliorer le soutien aux activités de recherche notamment dans la négociation de marchés plus adaptés aux fonctionnements des laboratoires
- Poursuivre l’amélioration de la bibliométrie à Paris 1 en mettant en place une veille éditoriale des publications accessible à tou.tes en s’appuyant sur le socle que constitue HAL et en collaboration avec le service de la documentation (SCD).
- Augmenter le nombre de CRCT (Congés pour recherches ou conversions thématiques) à partir du budget de l’établissement ou de financements provenant d’organismes publics ou privés dans le cadre de convention de recherche ou de formation, avec l'objectif de permettre à chaque collègue de bénéficier d'un CRCT tous les cinq ans.
- Développer et soutenir une offre de formation pour les EC tout au long de la vie, sur les nouveaux outils de la recherche et plus spécifiquement sur les usages de l’IA, en leur dégageant du temps pour le faire.
Renforcer la valorisation :
- Jouer tout son rôle en matière de socialisation et de médiation scientifique. L’engagement de l’université dans le mouvement de la science ouverte offre un socle essentiel pour une politique volontariste de renforcement des liens entre science et société dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mettre résolument la communication de l’établissement à l’écoute de la vie de la recherche à Paris 1. Renforcer les compétences de communication scientifique chez les enseignants chercheurs et des doctorants en développant la formation de medias training.
- Soutenir une politique de traduction ambitieuse et accompagner le développement des outils d’aide à la traduction automatique dans les centres de recherche.
- Mettre en place une politique de conservation dans la durée des bases de données et d’usage des logiciels, en partenariat avec le CNRS, Progedo et HumaNum.
- Doter davantage les politiques d’exposition des travaux scientifiques sur nos sites, en en particulier sur le Campus Condorcet et envisager un lieu d’exposition, par exemple par une politique volontariste de restauration de la chapelle de la Sorbonne.
Une recherche attentive aux grands enjeux du monde
- Refuser un code de déontologie qui briderait les libertés académiques des enseignants-chercheurs en limitant leur prise de positions publiques à leur périmètre disciplinaire.
- Prendre toute sa place dans la lutte contre l’augmentation des propos antiscience, en particulier dans le domaine des SHS dont on sait le grand potentiel d’instrumentalisation par les discours pseudo-scientifique.
- Associer la recherche à notre environnement par des partenariats locaux sur nos différents sites, autour de projets de recherche, de vulgarisation et de projets pédagogiques.
- Organiser une fois par an, ou tous les deux ans, une semaine « Université ouverte » de colloques et débats avec nos différents laboratoires et nos partenaires de Sorbonne Alliance ou UNA Europa sur les grands enjeux de société.
- Associer services, laboratoires et composantes de nos trois familles disciplinaires de l’université dans une réflexion commune sur l’IA (Intelligence artificielle), ses normes, ses usages. Le développement d’un Lab IA nécessitera des équipements, notamment de supercalculateurs et de la puissance de stockage. Cela ne peut se faire sans un partenariat avec le CNRS ou avec d’autres universités.
soutenir ET Renforcer LES DOCTORANTS ET la formation doctorale
- Renforcer et formaliser la formation doctorale. Le collège des écoles doctorales (ED) doit être redynamisé. Elles n’ont pas été l’objet d’attention particulière, sauf la mise en place du logiciel Adum, qui n’est pas sans susciter des interrogations. Le volume de formation reste très limité et la signature des cotutelles laborieuse. L’enseignement doctoral ne bénéficie d’aucune reconnaissance dans les services enseignants. La mise en commun de formations transversales offertes par le collège des ED a été un remède à cette pénurie d’heures de formation. Il faut donc dégager des moyens pour renforcer la formation doctorale.
- Renforcer le lien entre le Master 2 et le doctorat, notamment dans les laboratoires, pour organiser des séminaires communs de formation à la recherche obligatoires et reconnus. Et réfléchir à l’établissement progressif d’un système de graduate englobant M2 et D, reconnu dans les services, tout en maintenant la spécificité du D. Mettre en place un véritable parcours doctoral reconnu par des ECTS et dans les services des enseignants-chercheurs.
- Accompagner l’insertion professionnelle des doctorant•es. Développer des « Doctoriales », et les rencontres entre les doctorants et l’écosystème où ils sont susceptibles de trouver des emplois, les accompagner dans la reconnaissance et la médiatisation de leur recherche hors du périmètre universitaire (entreprise, presse, association, média, organisme public).
- Renforcer le service d’offres post-doctorales du bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP). Mettre en place des séminaires internationaux, polyglottes, sur le modèle de certaines EUR (Écoles universitaires de recherches) que compte Paris1, avec un système d’alternance dans une même année sur deux sites. Soutenir les ED pour leur permettre de se développer et de poursuivre leur labellisation.