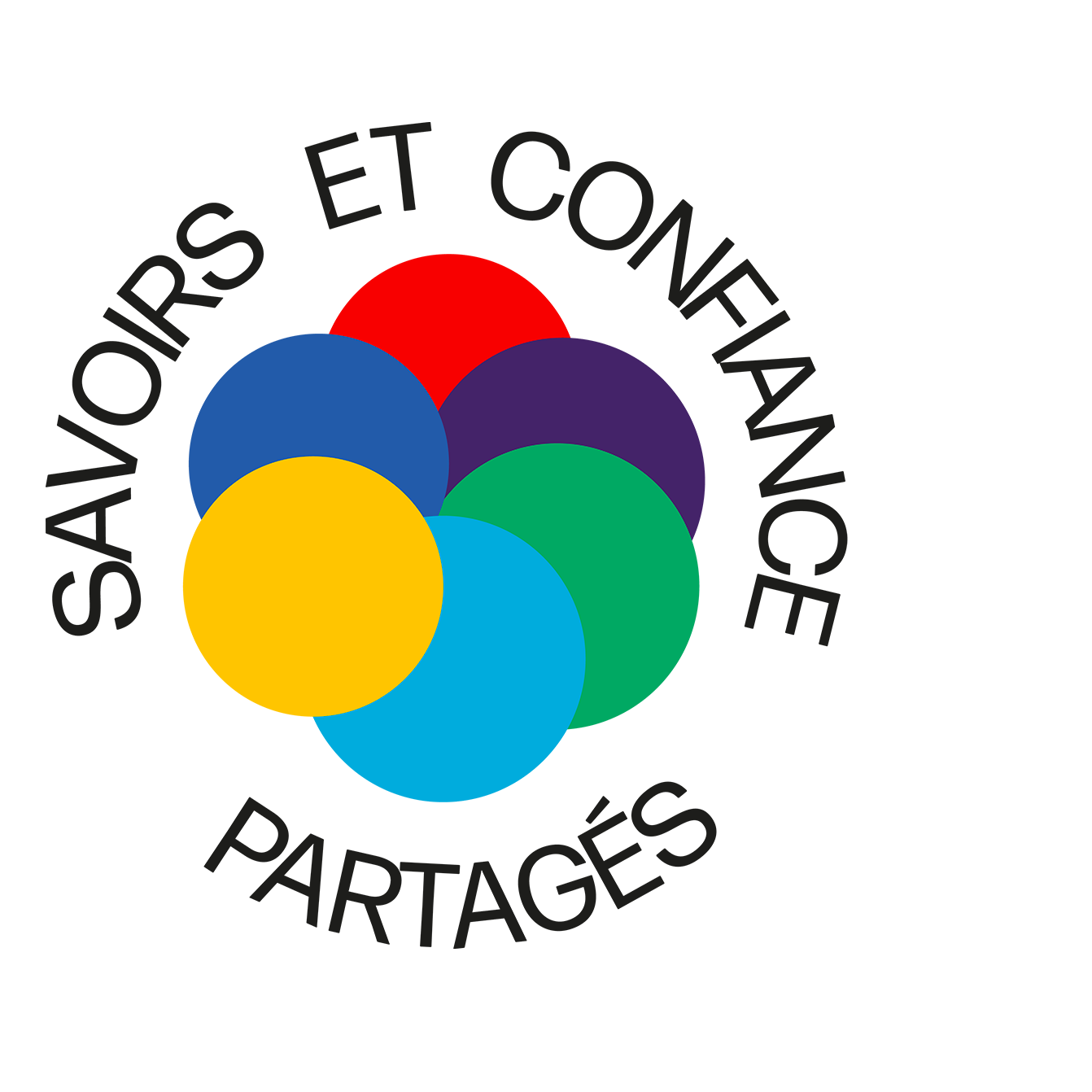Faire confiance à toutes et tous
Soutenir l’enseignement et la recherche, c’est donner la priorité aux réalisations et aux réussites dans les unités de formation et les centres de recherche. C’est faire confiance et admettre que notre excellence académique tient aux enseignements, aux publications et aux conférences de chacun.
Il faut en conséquence :
- Réduire les processus de validation afin de favoriser les initiatives et les innovations au niveau le plus proche de ceux qui les conçoivent et les mettent en œuvre ;
- Simplifier la mise en œuvre des budgets et rendre transparente l’utilisation des ressources propres ;
- Pourvoir sans délais les postes de ressources humaines, afin qu’elles aient les moyens de leurs missions.
Pour atteindre ces objectifs, la première urgence est de réunir l’ensemble des services afin que soit mise en place une coordination efficace. Toute organisation est source de complexité, mais celle-ci doit demeurer maîtrisée.
Soutenir les personnels de bibliothèque, d’administration, de services techniques, sociaux et de santé (Biatss), c’est en premier lieu reconnaître toute leur place dans la conduite de notre mission de service public. Sans leur contribution, notre université serait à l’arrêt. C’est en conséquence leur proposer une politique concertée, transparente et significative sur la question des rémunérations. C’est aussi leur proposer des évolutions de carrière accessibles et raisonnées. C’est encore leur offrir des formations ad hoc pour leur permettre de s’adapter aisément aux évolutions des outils numériques. C’est promouvoir une gestion raisonnée des ressources humaines loin des rigidités hiérarchiques, attentive aux savoirs et à l’expertise des uns et des autres. C’est enfin expliquer les choix stratégiques des unités d’enseignement et de recherche et ainsi associer les femmes et les hommes à la réussite d’un projet commun.
Soutenir les étudiantes et les étudiants, c’est d’abord leur offrir le meilleur enseignement possible. Mais là comme ailleurs, faisons-nous confiance. Notre communauté académique, dont les vacataires et les professeurs du secondaire détachés sont parties prenantes, doit pouvoir innover dans la formation initiale et tout au long de la vie. De nombreuses initiatives pédagogiques visant à mieux partager nos savoirs existent déjà, il faut les mettre en valeur et les développer.
C’est ensuite garantir aux étudiantes et étudiants un cadre de vie propre à leur épanouissement et, pour beaucoup d’entre eux, propre à les arracher à leur isolement. Il faut donc soutenir les initiatives des associations d’étudiants, définir et mettre en œuvre une politique d’Alumni, aujourd’hui non aboutie, créer des espaces et des moments d’intégration, proposer une billetterie de spectacles, comme il est d’usage dans toutes les grandes universités. Il faut aussi continuer l’effort entrepris pour aider les étudiants en difficulté, les accompagner dans les démarches pour obtenir des aides sociales, un logement. Il faut les accompagner dans le handicap, les soutenir dans les démarches de soin. Et être à l’écoute des déclarations de harcèlement et réactif.
Soutenir les étudiantes et les étudiants, c’est leur faciliter la mobilité internationale. Pour en assurer le financement, il faut dynamiser la politique de mécénat à l’œuvre au sein de notre fondation, pour l’heure insuffisamment efficace.
PARTAGER LES SAVOIRS
La confiance passe aussi par la reconnaissance des compétences de chacun. Il faut partager les savoirs des enseignantes-chercheuses et des enseignants-chercheurs avec l’expertise des Biatss, par exemple sur le numérique, les bases de données, la documentation. Il y a une absolue complémentarité des missions d’enseignement, de recherche et de leur administration. Nos unités de formation et de recherche tiennent aussi leur prestige de leur appartenance à notre grande maison qui a récemment célébré son cinquantenaire et qui a un patrimoine documentaire à nul autre pareil. Il faut continuer de désirer et donc d’entretenir ce qu’on possède, notre héritage.
Le partage de nos savoirs passe aussi par le respect de nos valeurs et traditions communes. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de respecter la règle dite du tourniquet, qui prévoit tous les quatre ans une présidence issue d’une de trois grandes familles disciplinaires. Ce droit de coutume est un élément constitutif de notre vivre-ensemble depuis cinquante ans. La méconnaissance de cette règle coutumière entame la confiance et sape les principes de notre collégialité, ne serait-ce qu'en obligeant à porter un jugement sur le bilan de la précédente gouvernance et de la sorte à porter la critique, au risque de sévères discordes. De plus, le départ programmé de l’équipe sortante par le tourniquet libérait l’engagement des personnels dans la campagne électorale de toute interférence dans la gestion des affaires courantes et de toute crainte de compromettre la conduite des projets.
Il est aussi nécessaire de rester fidèle à notre tradition d’ouverture, marquée par le décloisonnement des disciplines. A l’heure de la multiplication des sites par grandes familles disciplinaires, il faut trouver les moyens de continuer à faire communauté. La lettre interne de Paris 1 est assurément un bon vecteur de partage, levier possible de coopérations transdisciplinaires. Mais il faut aller plus loin dans la mutualisation des formations et des savoirs, dans des collaborations non-académiques et dans l’ouverture à différents publics. Notre vie universitaire doit être marquée, au moins une fois l’an, par une manifestation thématique, de rayonnement international, réunissant nos différentes familles, qui pourraient se tenir sur d’autres sites que le Panthéon ou la Sorbonne, afin de réunir notre communauté, dispersée géographiquement.
Partager nos savoirs comme notre patrimoine de bibliothèques, c’est enfin les valoriser au-delà de nos enceintes. Sans doute peut-on à juste titre faire état de la présence de nos collègues dans les médias. Pour autant, une politique ambitieuse destinée à faire rayonner nos réalisations académiques ne peut se satisfaire d’une simple résonnance radiophonique ou télévisuelle. Il y a donc lieu de créer au sein de l’université les médias nécessaires à la diffusion et à l’incarnation de nos savoirs. C’est à l’université de faire l’événement. Sur ce sujet, force est d’admettre qu’il y a encore à faire. Bien que richement doté, le projet Sorbonne TV n’a pas encore vu le jour. Comment faire ? D’abord en faisant l’inventaire de toutes les réalisations achevées ou en cours dans nos différentes unités ; ensuite en croisant les expériences et en partageant les réussites ; Enfin, en développant un média faisant ressortir les manifestations les plus susceptibles d’intéresser un large public.
Ces propositions ne sont pas des incantations. Dans le bref temps de la campagne, nous allons déployer dans des documents courts, nos propositions détaillées. Mais voici déjà les éléments principaux.