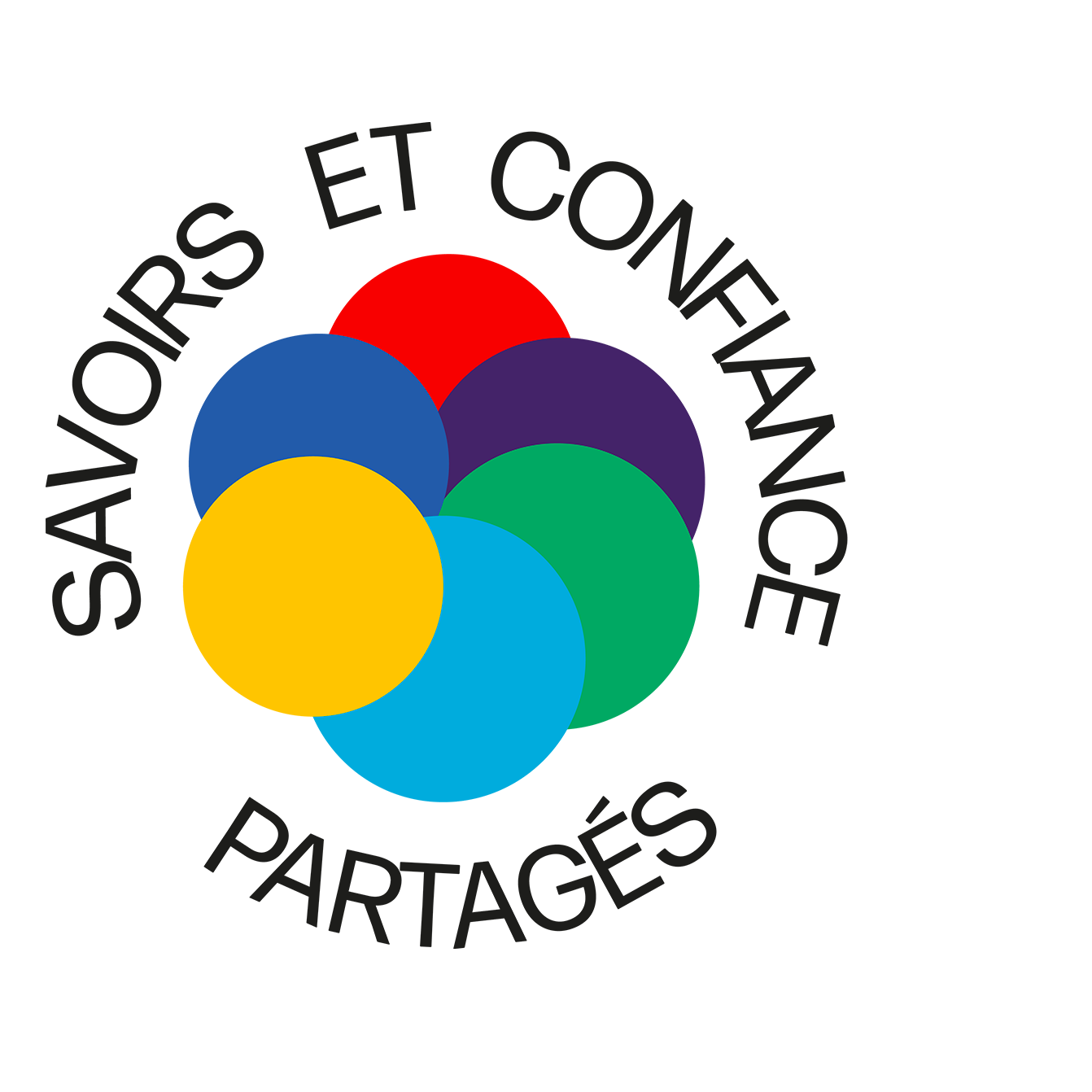De même qu’accroître le temps offert aux enseignants chercheurs est la ligne d’horizon de la liste Savoirs et confiance partagés, l’internationalisation de notre université par les formations est un objectif à développer. C’est notre mission de service public d’aider nos étudiants à s’insérer dans le vaste monde mais aussi d’accueillir ceux qui désirent étudier en français ou en France. Notre stratégie doit donc être plurielle et adaptée aux attentes des étudiantes et étudiants comme aux pratiques de nos différentes disciplines.
Comment favoriser la mobilité étudiante ?
Comment favoriser la mobilité étudiante ?
Entrante ou sortante, elle reste trop limitée : en raison de soucis matériels principalement
et du niveau linguistique secondairement.
- Pour nos étudiants qui souhaitent partir un an ou six mois à l’étranger, le risque de perdre son logement en Ile-de-France et son petit boulot sont des entraves importantes. Et le coût des études
à l’étranger (notamment des locations ou colocations) reste très dissuasif, malgré les aides Erasmus (en Europe) et les aides à la mobilité internationale de la CEVEC. En outre, distribuées sur critères sociaux, ces aides ne touchent pas ceux qui ont trop pour y prétendre, mais pas assez pour partir.
- Un levier pour lever cet obstacle sera de s’appuyer sur le mécénat et de transformer la fondation universitaire en fondation partenariale afin qu’elle puisse aider de manière significative les mobilités étudiantes sortantes.
- Quant au décalage linguistique, il faut y remédier en renforçant l’enseignement des langues étrangères pour mettre l’université aux normes du cadre européen commun de référence pour
les langues.
Comment accueillir aussi davantage d’étudiants étrangers ?
- Tout d’abord en systématisant la formation en FLE, français langue étrangère, sous la forme de cours ou d’école d’été vers le début septembre.
- Ensuite en offrant une cartographie des enseignements en anglais déjà effectués dans nos UFR et en proposant des parcours entre nos UFR qui soient pertinents et adaptés à nos coopérations internationales en licence.
- Enfin en travaillant à des solutions d’hébergements de moyenne durée (5 mois).
Comment développer davantage l’offre de formation internationale ?
- En soutenant la création de diplômes internationaux pour structurer les parcours de mobilité, à l’image du collègue Franco-Anglais en droit, du master Franco-Allemand en Histoire ou des parcours de mobilité mis en place en histoire de l’art avec Bologne en M2, liste non exhaustive.
- En déployant aussi nos campus internationaux, notamment francophones comme ceux que les juristes ont su déployer en Roumanie, en Égypte, au Maroc et en Argentine par des accords bilatéraux. Le Brésil serait un bel horizon.
- Il nous faut envisager d'être plus présent dans les aires où l’université, la pensée et la langue françaises jouissent encore d’une aura susceptible de séduire ceux et celles qui ne se résignent pas à une anglobalisation du monde académique.
et du niveau linguistique secondairement.
- Pour nos étudiants qui souhaitent partir un an ou six mois à l’étranger, le risque de perdre son logement en Ile-de-France et son petit boulot sont des entraves importantes. Et le coût des études
à l’étranger (notamment des locations ou colocations) reste très dissuasif, malgré les aides Erasmus (en Europe) et les aides à la mobilité internationale de la CEVEC. En outre, distribuées sur critères sociaux, ces aides ne touchent pas ceux qui ont trop pour y prétendre, mais pas assez pour partir.
- Un levier pour lever cet obstacle sera de s’appuyer sur le mécénat et de transformer la fondation universitaire en fondation partenariale afin qu’elle puisse aider de manière significative les mobilités étudiantes sortantes.
- Quant au décalage linguistique, il faut y remédier en renforçant l’enseignement des langues étrangères pour mettre l’université aux normes du cadre européen commun de référence pour
les langues.
Comment accueillir aussi davantage d’étudiants étrangers ?
- Tout d’abord en systématisant la formation en FLE, français langue étrangère, sous la forme de cours ou d’école d’été vers le début septembre.
- Ensuite en offrant une cartographie des enseignements en anglais déjà effectués dans nos UFR et en proposant des parcours entre nos UFR qui soient pertinents et adaptés à nos coopérations internationales en licence.
- Enfin en travaillant à des solutions d’hébergements de moyenne durée (5 mois).
Comment développer davantage l’offre de formation internationale ?
- En soutenant la création de diplômes internationaux pour structurer les parcours de mobilité, à l’image du collègue Franco-Anglais en droit, du master Franco-Allemand en Histoire ou des parcours de mobilité mis en place en histoire de l’art avec Bologne en M2, liste non exhaustive.
- En déployant aussi nos campus internationaux, notamment francophones comme ceux que les juristes ont su déployer en Roumanie, en Égypte, au Maroc et en Argentine par des accords bilatéraux. Le Brésil serait un bel horizon.
- Il nous faut envisager d'être plus présent dans les aires où l’université, la pensée et la langue françaises jouissent encore d’une aura susceptible de séduire ceux et celles qui ne se résignent pas à une anglobalisation du monde académique.